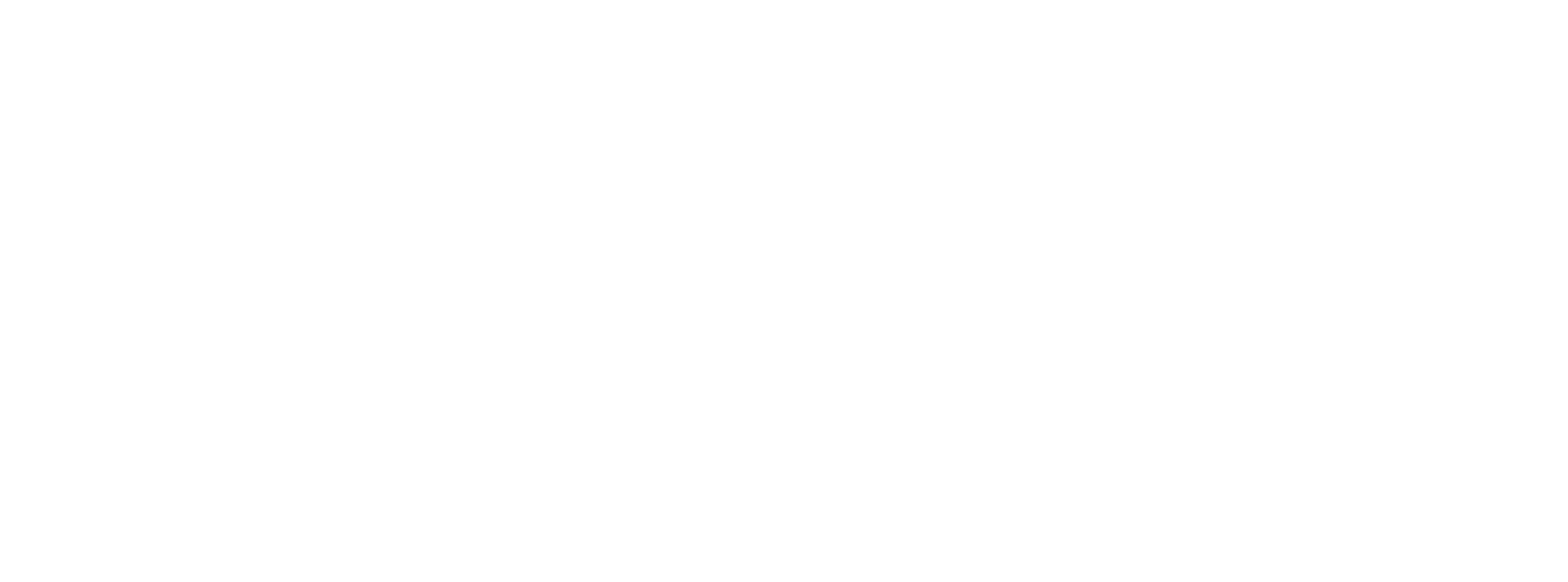Le comptage des loups : une source de tension entre l'OFB et les éleveurs
Le comptage des loups : une source de tension entre l'OFB et les éleveurs
1013 loups recensés en France, un chiffre qui attise la discorde entre l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et les éleveurs, ces derniers remettant en cause la fiabilité du comptage.
Introduction
Le loup est de retour en France, mais son comptage suscite une vive controverse. L'OFB annonce 1013 individus, un chiffre qui déclenche la colère des éleveurs. Comment expliquer ce désaccord ? Le suivi des populations de loups est crucial, tant pour la préservation de cette espèce protégée que pour la gestion des conflits avec les activités humaines, notamment l'élevage. Or, l'estimation annuelle de l'OFB, fixée à 1013 loups, est perçue par les éleveurs comme une sous-estimation flagrante de la réalité du terrain. Ceux-ci témoignent d'une pression de prédation bien supérieure à ce que suggèrent les chiffres officiels. Cet article se propose d'explorer les racines de cette divergence, en examinant la méthode de comptage de l'OFB et en donnant la parole aux éleveurs. Nous analyserons les conséquences de ce conflit sur les politiques de gestion du loup et la cohabitation entre l'homme et l'animal, et proposerons des pistes pour une meilleure transparence et un dialogue apaisé. Au-delà du simple chiffre, c'est l'avenir du loup en France et la relation entre les acteurs du monde rural et cette espèce emblématique qui sont en jeu.
La méthode de comptage de l'OFB
Pour estimer la population de loups en France, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) a mis en place une méthode rigoureuse axée sur l’analyse génétique. Considérée plus fiable que les précédentes, cette méthode s’appuie sur la collecte et l’analyse d’indices de présence du loup, tels que des traces de prédation, des excréments ou des poils, permettant un prélèvement d’ADN.
Durant l’hiver, période propice à la collecte de ces indices, l’OFB déploie un plan d’échantillonnage territorialisé. Ce plan repose sur un maillage précis du territoire, divisé en carrés de 10 km de côté. Cette approche permet de concentrer les efforts de recherche dans les zones où la présence du loup est avérée ou suspectée, tout en menant des prospections exploratoires dans des territoires vierges de toute indication.
Les échantillons collectés sont ensuite analysés en laboratoire afin d’identifier chaque individu et de confirmer son appartenance à l’espèce loup. L’analyse génétique permet ainsi d’individualiser les loups, d’évaluer la taille des meutes et de suivre leurs déplacements. L’OFB privilégie cette approche scientifique pour sa rigueur et sa précision, la jugeant supérieure aux observations directes, potentiellement biaisées.
Grâce à cette méthode, l’OFB a estimé la population lupine à 1013 individus durant l’hiver 2023-2024. Ce chiffre, quasi stable par rapport à l’estimation de mai 2024 (1003 loups), a servi de base pour déterminer le plafond de destructions autorisées pour 2025, fixé à 192 loups, soit 19% de la population estimée. Ce quota, inférieur à celui de 2024 (204 loups), suscite des réactions contrastées, notamment chez les éleveurs, confrontés à la pression croissante de la prédation. L’OFB, quant à elle, défend la fiabilité de sa méthode et la nécessité d’un suivi scientifique rigoureux pour une gestion efficace de la population lupine.

Les arguments des éleveurs
Aux yeux des éleveurs, l'estimation de 1013 loups en France, avancée par l'OFB, sonne faux. Leur réalité quotidienne, rythmée par les attaques et la crainte pour leurs troupeaux, contraste fortement avec les données génétiques et les projections statistiques. Fort de leur expérience du terrain, ils remettent en cause la fiabilité du comptage officiel.
Le nombre croissant d'attaques et de victimes est au cœur de leur contestation. Les données de la FNSEA sont sans appel : + 4,6% d'attaques et + 10,6% de victimes par rapport à 2023, avec 66 départements touchés par la prédation. Claude Font, secrétaire général de la Fédération nationale ovine, témoigne de ce sentiment d'abandon : « J'ai un sentiment d'abandon, vraiment, de l’élevage et du pastoralisme. ». L'augmentation des attaques sur les bovins, qui représentent désormais 7,5% du total, est un autre sujet d'inquiétude. Pour les éleveurs, ces chiffres ne sont pas de simples statistiques, mais la traduction d'une angoisse permanente, d'un surcroît de travail et de pertes financières importantes.
La pression de la prédation, vécue au quotidien, est difficilement mesurable par les seules analyses génétiques. Les témoignages d'éleveurs, confrontés à des attaques parfois répétées, illustrent cette réalité. Bernard Mogenet, représentant la FNSEA au groupe national loup, qualifie le chiffre officiel de « largement sous-évalué », s'appuyant sur les observations de terrain des éleveurs et même de certains citadins. Les indices de présence, constatés sur le terrain, dépassent largement les données collectées par l'OFB.
Le boycott de la réunion du groupe national loup en décembre 2024, initié par la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs et les Chambres d’agriculture, traduit la profonde frustration des éleveurs. La diffusion du chiffre de 1013 loups dans la presse avant la réunion a été perçue comme une provocation. Ce boycott symbolise la perte de confiance dans la méthode de comptage de l'OFB et la nécessité d'un dialogue plus transparent et constructif. Au-delà du simple chiffre, c'est la reconnaissance de leur situation et la mise en place de solutions efficaces qui sont réclamées par les éleveurs.
Les conséquences des divergences
Le désaccord persistant entre l'OFB et les éleveurs quant au nombre de loups présents sur le territoire français a des répercussions directes sur les stratégies de gestion de cette espèce et accentue les difficultés de cohabitation entre le prédateur et les activités pastorales.
L'autorisation d'abattage de 192 loups pour 2025, chiffre inférieur aux 204 permis en 2024, est calculée sur la base des estimations de l'OFB. Cette divergence de perception nourrit la frustration des éleveurs qui jugent ce quota insuffisant face à la pression prédatrice qu'ils subissent. Ils déplorent également le manque de considération pour leurs observations de terrain, considérées comme essentielles pour évaluer la population lupine. Ce décalage entre les chiffres officiels et la réalité vécue par les éleveurs soulève des questions cruciales sur l'efficacité des politiques publiques de gestion du loup.
La prédation sur les troupeaux bovins, en augmentation constante, illustre la complexité de la situation. Si elle ne représente que 7,5% des attaques totales, cette tendance inquiète les éleveurs et nécessite une adaptation des mesures de protection. Des modifications réglementaires sont d'ailleurs en cours d'élaboration pour renforcer la protection des bovins, s'inspirant des dispositifs déjà existants pour les ovins. L'augmentation globale des attaques (+40%) et du nombre de victimes (+80%), notamment dans les zones nouvellement colonisées par le loup, souligne l'urgence d'agir.
Cette divergence d'estimation a des conséquences palpables sur le terrain. Elle entraine une méfiance croissante des éleveurs envers les instances officielles et complique la mise en place de solutions concertées. La cohabitation entre l'homme et le loup, déjà fragile, est mise à rude épreuve. L'enjeu dépasse la simple question du comptage : il s'agit de trouver un équilibre entre la préservation d'une espèce protégée et la viabilité des activités d'élevage, dans un contexte de défiance et d'incompréhension mutuelle.

Conclusion : vers une meilleure gestion du loup ?
Le débat autour du comptage des loups en France révèle une profonde divergence entre l'approche scientifique de l'OFB, axée sur les analyses génétiques, et le vécu des éleveurs, confrontés à la réalité tangible des attaques sur leurs troupeaux. L'OFB défend la rigueur de sa méthode, tandis que les éleveurs pointent du doigt une sous-estimation flagrante de la pression du loup, étayée par l'augmentation des attaques, notamment sur les bovins, et l'expansion géographique du prédateur.
Cette divergence de perception a des conséquences directes sur les mesures de gestion. L'autorisation d'abattage de 192 loups pour 2025, inférieure au quota de 2024, est jugée insuffisante par les éleveurs, qui perçoivent un manque de considération pour leurs observations de terrain. Le boycott de la réunion du groupe national loup témoigne de la rupture de confiance entre les deux parties. Au-delà du simple chiffre, c'est la méthode d'estimation elle-même qui est remise en question. Comment concilier l'approche scientifique avec la réalité du terrain ?
Pour apaiser les tensions et construire une gestion efficace du loup, plusieurs pistes méritent d'être explorées. Améliorer la transparence des données et des calculs de l'OFB, intégrer davantage les observations des éleveurs dans le processus d'estimation, et repenser les modalités du dialogue entre les acteurs concernés sont autant de leviers pour restaurer la confiance. Une meilleure prise en compte de la dynamique des meutes, notamment leur reproduction, pourrait affiner les estimations. Enfin, une réflexion sur l'équilibre entre la protection du loup et la viabilité économique des élevages est indispensable. Face à ces enjeux complexes, quelles solutions concrètes pourraient être mises en œuvre ? Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus.