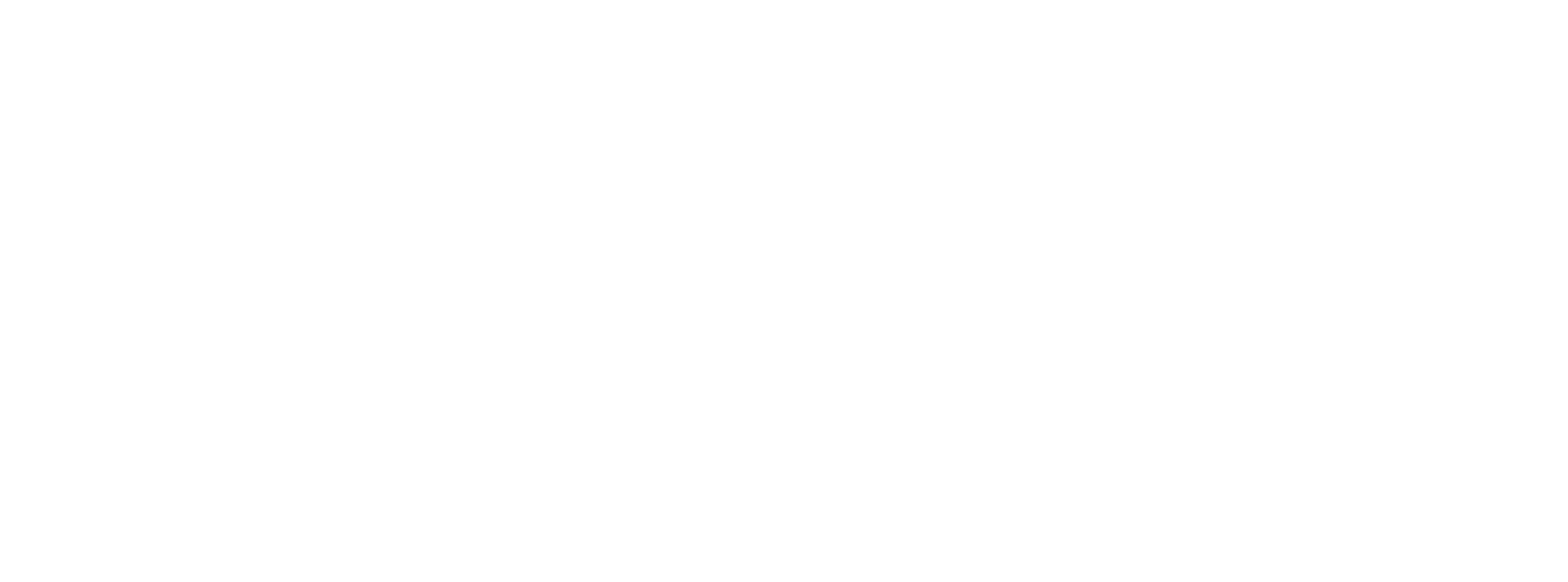Des vaches et des cochons : le duo qui a tout bon
Valoriser les atouts de la complémentarité des élevages porcins et bovins dans les territoires herbagers du Massif central. Telle est l’ambition du projet Aporthe, coordonné par l’Association porc de montagne, et soutenu par le commissariat de Massif¹. Le projet a démarré en 2019-2020 par une vaste enquête auprès des producteurs et des experts de la filière. Aujourd'hui, fort de ce travail d'enquête, les résultats sont plus que probants.
Quel est le poids de l'élevage porcin dans le Massif central ?
Le grand Massif central se distingue par une très faible densité porcine, de l’ordre de 3 porcs par km² (contre 21 à l’échelle nationale), mais par une très forte densité bovine de 11 unités gros bétail d’herbivores (UGB) par km². On y dénombre 1 500 sites porcins soit 11% des exploitations porcines françaises, qui ont produit en 2018, un million de porcs charcutiers.
« L’exploitation type produit 1 000 à 2 000 porcs, selon l’orientation engraisseur ou naisseur-engraisseur, et compte entre 60 et 70 vaches pour une centaine d’hectares », résume Hélène Rapey de l’Inrae de Clermont-Ferrand.
Les ateliers porcins sont plus présents en bordure du Massif central, au nord, au sud et à l’est, quels que soient les systèmes et les territoires herbagers.
Diversifier ses productions pour assurer l'équilibre économique de son exploitation agricole
« Historiquement, le porc est venu comme une activité de diversification pour compléter le revenu et valoriser une main d’œuvre disponible lors de l’instauration des quotas laitiers ou face à un foncier limitant. Le porc répond aussi au goût professionnel et personnel de certains éleveurs.
A l’échelle collective, la présence du porc contribue à la dynamique locale par l’activité qu’il génère dans les secteurs de l’abattage, de la transformation, de la consommation, du conseil et des services avec des retombées positives pour l’ensemble de l’économie et de l’emploi de la région », explique Christine Roguet du service économie de l’IFIP (Institut du Porc). Le revenu est le premier intérêt cité par les agriculteurs à la tête d’une exploitation mixte, devant la production d’effluents et l’organisation du travail. Si la charge de travail liée à l’articulation entre les deux productions demeure le principal inconvénient identifié, elle n’est pas pour autant rédhibitoire.
Autrement dit, la balance bénéfice-risque donne l’avantage à la mixité des productions, y compris lorsqu’il est question de durabilité.
Le projet Aporthe.
Des systèmes d'élevage plus durables car complémentaires
Ainsi le programme Aporthe a cherché en quoi la production porcine peut améliorer la durabilité des exploitations bovines.
« Nous avons travaillé à partir de 17 exploitations mixtes enquêtées pour effectuer nos simulations. Les résultats montrent que les systèmes mixtes sont plus rémunérateurs. Le revenu n’est pas nécessairement plus stable mais plus élevé, y compris pour les revenus les plus bas par rapport à des systèmes bovins spécialisés et les exploitations moins dépendantes des aides. Les systèmes mixtes rémunèrent plus de main d’œuvre par unité de surface. A noter également, l’augmentation de la production de protéine consommables par l’homme et la diminution du coût moyen de production pour ces élevages mixtes. Du point de vue environnemental, ces exploitations ont un moindre potentiel de réchauffement climatique par kilogramme de protéine produite et une meilleure gestion de la fertilisation », détaille Claire Mosnier, chargée de recherches Inrae, UMRH, Clermont-Ferrand-Theix.
L’apport de lisier de porc sur prairies est apprécié par les éleveurs du Massif central pour la rapidité de son action fertilisante.
Le lisier : un amendement précieux pour les champs et les prairies
Au pré, le recours au lisier fait toute la différence. Unanimement, les éleveurs témoignent de très bons résultats sur la fertilisation.
« Le lisier est un bon complément aux sols d’altitude souvent chargés en matière organique, se minéralisant difficilement compte tenu des conditions climatiques. Le lisier peut également redynamiser ponctuellement une prairie peu fertile (à petite dose : 10 à 15 m³/ha). Une bonne répartition des lisiers offre une meilleure gestion de la production herbagère au cours du temps », affirme Pascal Levasseur, ingénieur d’étude pôle techniques d’élevage de l’Ifip-institut du porc. En effet, les zones herbagères apportent en retour de la souplesse dans le choix des périodes d’épandage et la gestion des capacités de stockage. Pour aller plus loin, et pour la première fois, l’impact des pratiques d’épandage des effluents d’élevages mixtes « porcin-bovin » en zone herbagère du Massif Central sur la qualité microbiologique des sols a été étudié dans le cadre du projet par une équipe de chercheurs d’AgroSup Dijon et d’Inrae.
« Grâce aux indicateurs microbiologiques, il semblerait qu’une pratique plus vertueuse, c’est-à-dire extensive avec moins d’apports d’effluents et d’engrais de synthèse et une pression au pâturage plus faible, induise une augmentation significative de la biomasse microbienne », explique Sophie Bourgeteau enseignante - chercheuse en écologie microbienne des sols, à AgroSup Dijon.
¹ Aporthe implique différentes équipes de recherche pluridisciplinaires, parmi ses partenaires : les pôles techniques d'élevage et économie de l'IFIP, INRAE, Agro-Sup Dijon, IRSTEA et le Service interdépartemental des Chambres d'agriculture du Massif Central en lien avec l'Association Porc Montagne qui a piloté le programme, soutenu par l’Etat au travers du CGET.