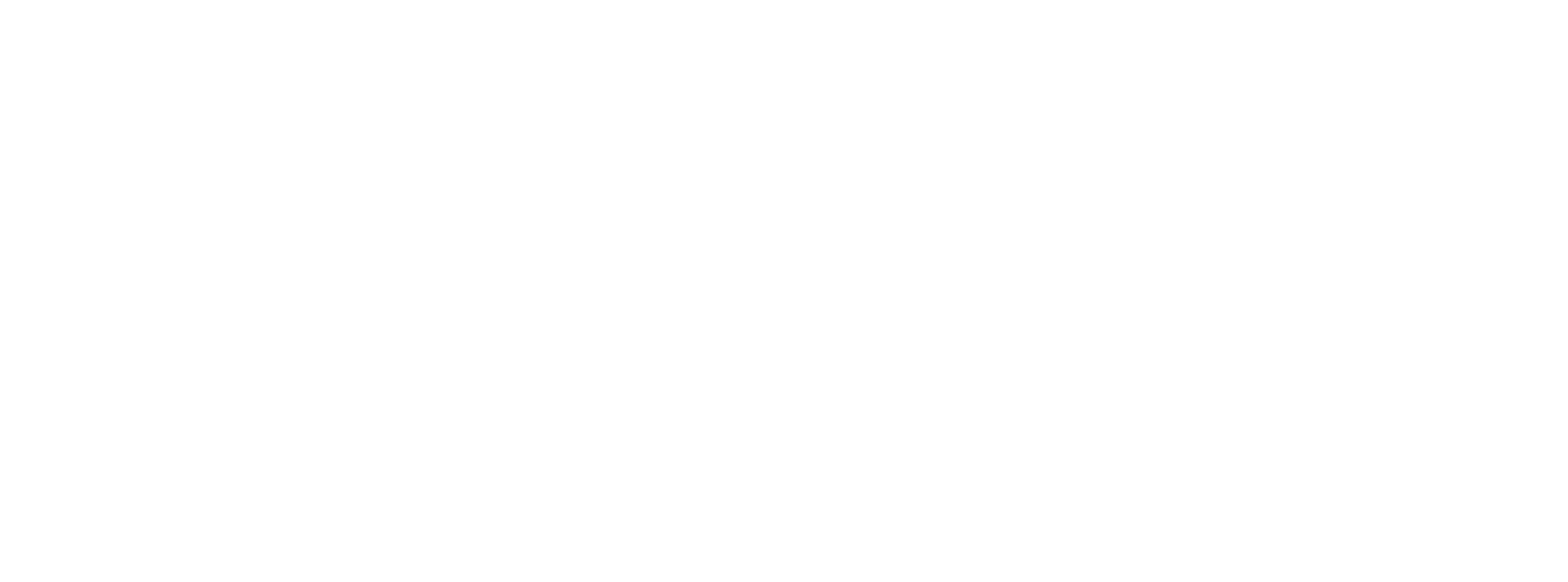Irrigation : Comment ajuster la consommation d'eau sans pénaliser le rendement ?
Les chiffres clés de l'irrigation en France
En 2020, l’eau prélevée pour l’irrigation en France métropolitaine représente environ 10 % des prélèvements totaux réalisés en eaux superficielles et souterraines.
Cette eau a servi à irriguer 1,8 million d’hectares (ha), soit 6,8 % de la surface agricole utile (SAU).
Si les exploitations maraîchères et horticoles sont les plus équipées en système d’irrigation (51 % d’entre elles), ce sont les cultures de maïs qui mobilisent le plus de surfaces irriguées (38 %) devant le blé (12 %) et les légumes frais, fraises et melons (9 %).
L’évolution des conditions climatiques a conduit les agriculteurs à s’équiper davantage, avec une augmentation moyenne des surfaces irrigables de 23 % entre 2010 et 2020. Cette augmentation a été particulièrement forte dans le nord de la France.
« Nous vivons une période de tension sur la ressource en eau, et les agriculteurs sont en première ligne »
Physicien de formation, Bruno Cheviron pilote l’équipe OPTIMISTE (Optimisation du pilotage des technologies d’irrigation, minimisation des intrants et transferts environnementaux) à l'INRAE-UMR Géo de Montpellier. Son équipe étudie les processus biophysiques liés à l’irrigation à différentes échelles, de la parcelle agricole au territoire. Trois approches complémentaires sont notamment expertisées : la métrologie des flux dans l’environnement c’est-à-dire la mesure de la quantité de substances dans l'eau, le sol et l'atmosphère qui permet de déterminer l'impact des activités humaines sur l'environnement, l’optimisation des modèles d’irrigation, et des recherches exploratoires sur l'irrigation urbaine pour lutter contre les îlots de chaleur.
L'irrigation est au cœur de la recherche pour apporter des solutions concrètes aux agriculteurs
Le chercheur insiste sur l'importance de fournir des outils concrets aux agriculteurs face aux contraintes croissantes :
« Ils sont confrontés à des défis énormes, comme les restrictions estivales ou le partage de la ressource. Notre rôle est de les accompagner pour mieux gérer l'eau tout en maintenant la viabilité économique de leurs exploitations agricoles. »
Parmi les solutions développées, les capteurs de métrologie des flux permettent de mesurer en temps réel l'humidité du sol et l'état hydrique des cultures.
« Ces données précises aident à prendre des décisions éclairées sur l’irrigation. Cela réduit le gaspillage d'eau tout en optimisant le rendement », précise-t-il. Le modèle d'optimisation de l'irrigation, quant à lui, simule différentes stratégies pour trouver le meilleur équilibre entre quantité d’eau utilisée, rendement et viabilité économique. "On peut l’utiliser en temps réel pour ajuster l'irrigation ou rétrospectivement pour analyser des stratégies passées et imaginer des scénarios futurs."
Gestion de l'eau : Un dialogue nécessaire entre la recherche et monde agricole
Cependant, Bruno Cheviron reconnaît la difficulté de faire le lien entre le monde académique et le terrain. "La connexion avec le monde opérationnel agricole n'est pas toujours évidente. Nous avons besoin de passeurs de savoirs : des ingénieurs agricoles, des conseillers ou encore des irrigants expérimentés capables de traduire nos recherches en solutions pratiques."
L’INRAE ne se contente pas de produire des connaissances théoriques. "Notre mission est de les décliner de manière appliquée en tissant des liens avec le monde agricole", explique-t-il. Pour cela, l'institut a développé un modèle d'optimisation d’irrigation : Optirrig, un outil logiciel de génération, d'analyse et d'optimisation de scénarios d'irrigation. Il s'appuie sur une description simplifiée de la croissance des plantes en fonction de l'évolution des ressources en eau et en azote du sol.
L'interface graphique intuitive de cet outil devrait, bientôt, être déployée à grande échelle.
Irrigation : moins de 1 % de la surface fourragère est irriguée en France
On estime à seulement 150 000 ha (essentiellement du maïs fourrage) les surfaces fourragères irriguées en France, sur les 15 millions d'hectares de surfaces fourragères totales destinées à l'élevage tricolore, soit 1 % environ de la surface. « Pourtant l'irrigation raisonnée serait la bienvenue en élevage afin de sécuriser la production fourragère dans un contexte de changement climatique », assure André le Gall de l'Institut de l'élevage, auteur de « Consommations d'eau en élevage : entre sobriété et résilience » (août 2022) . À une échelle plus globale, la part de l'agriculture dans les prélèvements bruts d'eau bleue en France est en moyenne de 9 % (entre 2010-2019), soit 2,9 milliards de mètres cubes prélevés, dont une partie se retrouve dans les produits végétaux et animaux destinés à l'alimentation humaine. 2,3 milliards de mètres cube sont consommés par les filières agricoles, les 0,6 Mdm3 restants rejoignent le milieu duquel ils ont été prélevés.
L'affouragement au pré est de plus en plus fréquent et précoce.
Consommation d'eau en élevage : stop aux idées reçues
Le cycle de l'eau lié à l'agriculture, source Idele 2023.
Il faut 550 à 700 litres d'eau pour produire 1 kg de viande
Dans sa publication, « Quelques idées fausses sur la viande et l'élevage », l'INRAE bat en brèche des fake news souvent basées sur des simplifications ou généralisations abusives sciemment entretenues par les détracteurs de l'élevage. Non, il ne faut pas 15 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande.
La communauté scientifique s'accorde à dire qu'il faut entre 550 et 700 l d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf. En eau utile, il faut 20 à 50 litres/kg dans le contexte français. L'empreinte eau des élevages laitiers est, elle, de l'ordre de 1 à 3 litres par litre de lait, loin des 150 litres fantaisistes qui circulent ici ou là.
L'intelligence artificielle pourrait consommer 4,2 à 6,6 milliards de mètres cubes d’eau en 2027
À titre de comparaison, on estime que la production d'un smartphone nécessite environ 2 500 litres d'eau. En moyenne, lorsqu'elle est présente dans le produit, la batterie, souvent composée de métaux rares, représente 40 % de cette empreinte (il faut 67 litres pour en extraire 1 gramme de métaux rares). L'intelligence artificielle est beaucoup plus gourmande en eau. En effet, selon un rapport du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), développer et entraîner ChatGPT-3 a demandé 700 000 l d’eau et ce chatbot consomme près un demi-litre d'eau pour générer 10 à 50 réponses.
À ce rythme, l’OCDE estime que l’IA pourrait consommer 4,2 à 6,6 milliards de mètres cubes d’eau en 2027, soit la moitié de ce que prélève tous les ans le Royaume-Uni.