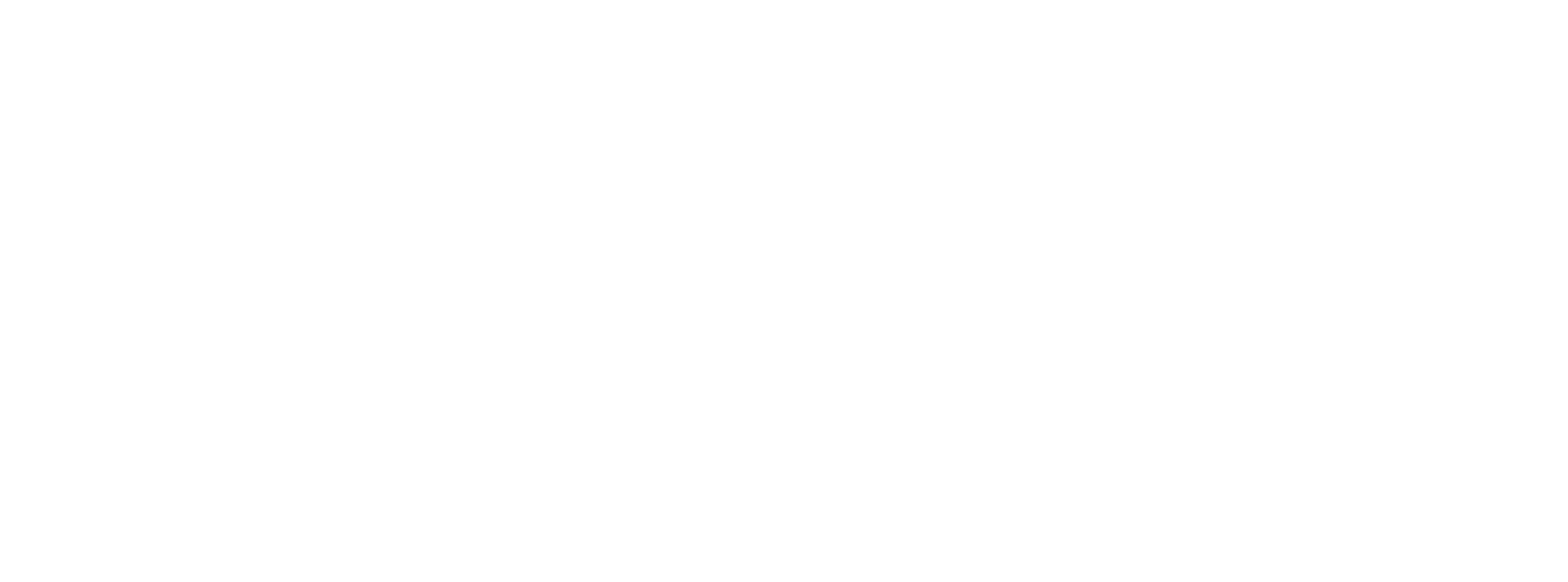Précipitations et évapotranspiration : quels scénarios à l'horizon 2050 ?
Né de la volonté des acteurs du monde agricole du Massif central de ne plus subir les évolutions climatiques mais de les anticiper, le projet AP3C (Adaptation des pratiques culturales au changement climatique) fournit des informations précieuses notamment sur la pluviométrie.
Combinant l'approche climatique, agronomique et systémique, le projet AP3C porté par le Sidam* livre régulièrement de nouveaux indicateurs agro-pédo-climatiques pour affiner la compréhension des impacts du changement climatique sur notre territoire. Objectif : permettre aux agriculteurs de se projeter à l'horizon 2050 en adaptant leur conduite d'exploitation. Parmi les indicateurs scrutés avec intérêt, figure le niveau de précipitations. Alors au final, pleut-il moins sur le Massif central, ce vaste territoire composé de 85 % d'herbe, souvent qualifié de château d'eau de la France ?
De marginales, les zones en déficit hydrique s'étendent
« Selon les projections, sur les deux-tiers nord à nord-est du Massif central, la dégradation du bilan hydrique potentiel annuel est de l’ordre de 100 mm en 50 ans entre 2000 et 2050, hors plaines de la Limagne et du Forez où elle peut atteindre les 150 mm. Elle correspond à très peu de choses près à l’augmentation de l'évapotranspiration potentielle (ETP). Sur le dernier tiers, au sud-ouest, on retrouve un gradient de 150 à 250 mm de dégradation, là où l’augmentation de l’ETP est à combiner avec la baisse des précipitations », analyse Vincent Caillez, climatologue du projet AP3C. Par ailleurs, le décalage vers un excédent moins important ou un déficit plus sévère est généralisé. La gamme de bilan hydrique potentiel qui pouvait atteindre de -400 à +1 000 mm, se décale de -550 à +900 mm. La répartition spatiale deux-tiers un tiers qui existait en 2000 en faveur des zones en excédent est ramenée à une égalité en 2050 par rapport aux surfaces en déficit. La zone de déficit de 400 mm annuel était marginale en 2000 mais elle s’étend sur une surface équivalente à un département en 2050, s’installant parfois au cœur du Massif.
Concernant les précipitations saisonnières, ce qui est saisissant c’est l’évolution positive, jusque +100 mm en 50 ans, durant l’été.
Vincent Caillez, climatologue
Moins de pluie au printemps et en hiver sur certains secteurs
Les évolutions des cumuls de précipitations au printemps sont majoritairement à la baisse, en moyenne de l’ordre de 50 mm en 50 ans mais avec des variations considérables de -200 à +10 mm. « Dans les zones de diminution sensible, il y a les reliefs exposés au flux général perturbé d’Ouest à Sud-Ouest indiquant une probable altération de ce flux mais la zone la plus impactée est celle des Cévennes ce qui indiquerait un moindre afflux d’air méditerranéen à cette saison ». En été, partout où l’air est suffisamment humide, la présence de reliefs élevés permet donc la formation de nuages d’averses d’autant plus que l’apport de chaleur sera important à l’avenir. Sur les zones centrales du Massif, le gain peut atteindre 50 à 80 mm, tandis qu’au sud du Massif (collines du Lot et chaîne cévenole), l’épuisement de l’humidité conduit à des baisses de cumul qui peuvent atteindre 30 à 50 mm. Dans ce genre de zone, les situations pourront être très contrastées (gain ou perte tendancielle) à quelques kilomètres d’écart. La comparaison directe des échéances 2000 et 2050 permet de voir un gain significatif sur les 3/4 nord du Massif, ainsi qu’une perte, également significative, sur le 1/4 sud. « Hormis la zone cévenole, la comparaison directe des échéances 2000 et 2050 permet simplement de se rendre compte d’une légère augmentation générale du cumul de précipitations automnal, tandis qu'en hiver la comparaison directe des échéances 2000 et 2050 permet de repérer les zones de forts cumuls, qui sont les reliefs exposés aux vents d’Ouest à Sud-Ouest d’une part et la zone cévenole d’autre part. Ces zones sont en maintien aux extrémités nord-ouest et sud-est mais en diminution ailleurs. En ce qui concerne les zones de très faible cumul (moins de 50 mm), on note l’accroissement de leur surface, particulièrement net dans la plaine de la Limagne ».
Évapotranspiration : du simple au double
La carte d’évolution du cumul annuel de l’ETP est particulièrement significative et essentiellement reliée à l’altitude ainsi qu’à la latitude. « Il est possible qu’une partie de la variabilité vienne également de la modification du régime des vents dominants (légère bifurcation vers le Sud attestée dans les travaux annexes du projet AP3C). Les évolutions vont du simple au triple (de + 60 à + 180 mm en 50 ans) parfois sur le même département (Lozère). La comparaison directe des échéances 2000 et 2050 permet de confirmer l’évolution générale de grande échelle, entre +100 et +200 mm. On peut également remarquer que les valeurs les plus élevées vers 2000 (1 100 mm vers le Gard) arrivent en plaine du Forez vers 2050 ».
* Service interdépartemental des Chambres d'agriculture du Massif central. Le projet AP3C est animé par le SIDAM avec les compétences des ingénieurs de 11 Chambres d’Agriculture (Allier, Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Haute-Vienne, Loire, Lot, Lozère et Puy-de-Dôme) et de l’Institut de l’élevage.