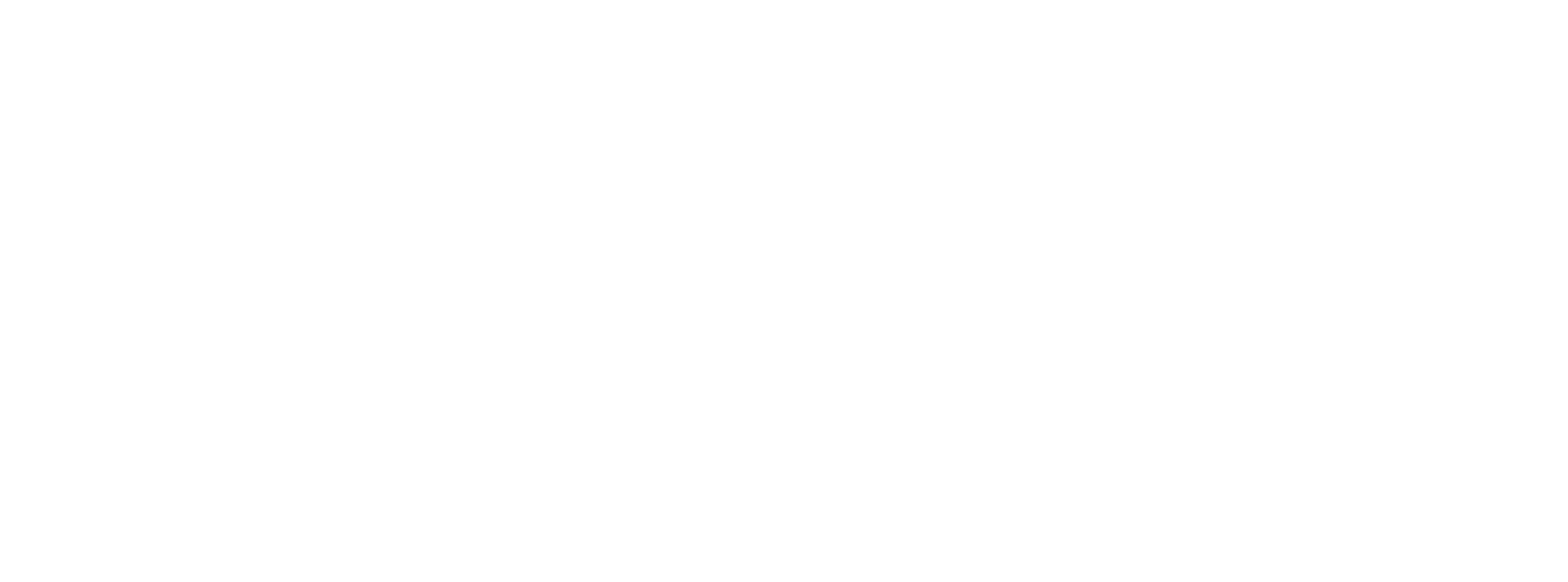Mercosur : concurrence déloyale et contradictions pour les éleveurs
Mercosur : les agriculteurs soumis à une concurrence déloyale et à des contradictions toujours plus fortes
Le Mercosur : une menace réelle pour vos troupeaux ? Cet accord commercial pourrait bouleverser le paysage de l’élevage français. Découvrez les enjeux et les conséquences potentielles pour votre activité.
Comprendre les enjeux du Mercosur pour les professionnels de l’élevage
Le Mercosur, accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, suscite de vives inquiétudes chez les éleveurs français. Visant à supprimer les barrières douanières et à intensifier les échanges commerciaux, cet accord pose la question : à quel prix ? Pour les professionnels de l’élevage, en particulier, décortiquer les implications du Mercosur est crucial. Identifier les opportunités, certes, mais surtout anticiper les risques potentiels est essentiel pour adapter les stratégies et préserver la compétitivité des filières françaises. Cet article analyse en détail les enjeux du Mercosur pour vous, éleveurs. Nous aborderons la question de la concurrence déloyale, les conséquences économiques potentielles sur les différentes filières d’élevage françaises, les arguments des défenseurs de l’accord, et enfin, l’impact environnemental, une préoccupation majeure pour l’avenir du secteur.
Une concurrence déloyale ?
L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur inquiète les éleveurs français, qui craignent une concurrence déloyale. Leur principale préoccupation : la différence de normes sanitaires et environnementales entre les deux régions. En Europe, les éleveurs doivent respecter des réglementations strictes, impactant leurs coûts de production. L’abandon de certaines molécules, la prise en compte de la biodiversité et la qualité de l’alimentation animale sont autant d’exemples d’exigences qui augmentent les dépenses des exploitations françaises.
De l’autre côté de l’Atlantique, les pays du Mercosur appliquent des normes moins strictes. L’utilisation d’hormones de croissance, d’antibiotiques et de pesticides interdits en Europe, par exemple, permet aux éleveurs sud-américains de produire à moindre coût. Cette différence de normes crée un déséquilibre concurrentiel, les produits du Mercosur pouvant être proposés à des prix plus bas sur le marché européen.
L’accord prévoit un quota d’importation de 99 000 tonnes de viande bovine par an, à un taux de douane réduit de 7,5%. Ce volume représente 1,6 % de la production annuelle de l’UE et s’ajoute aux importations existantes. Si ce chiffre peut paraître faible, il concerne principalement les morceaux nobles du bœuf (aloyaux), comme le filet ou l’entrecôte. Ces morceaux, plus chers, influencent les prix du marché. L’arrivée massive de viande bovine sud-américaine, moins chère, pourrait donc déstabiliser les prix européens et impacter les revenus des éleveurs français.
Par ailleurs, un rapport de 2020 révèle que 12 % des aliments importés du Brésil vers l’UE contenaient des résidus de pesticides interdits en Europe. Ces pratiques, ajoutées à la déforestation et aux longs trajets de transport, soulèvent des questions environnementales et sanitaires importantes. Face à ces préoccupations, la justification de l’accord Mercosur apparaît difficile pour de nombreux acteurs du secteur agricole français.
 @Stijn te Strake
@Stijn te StrakeLes conséquences économiques pour les filières d’élevage françaises
L’accord Mercosur pourrait fortement impacter l’économie des filières d’élevage françaises. L’arrivée de produits sud-américains à bas prix risque de déstabiliser les marchés et de menacer la viabilité de nombreuses exploitations.
Filière bovine : L’importation de 99 000 tonnes de viande bovine, principalement des morceaux nobles (aloyaux), représente une menace directe pour les éleveurs français. Cette concurrence accrue pourrait entraîner une baisse significative des prix du marché. Si le quota représente 1,6 % de la production annuelle de l’UE, son impact sur les prix des aloyaux, qui influencent l’ensemble du marché, pourrait être bien plus important. À cela s’ajoute la difficulté de contrôler l’application des normes sanitaires et environnementales dans les pays du Mercosur, source d’inquiétude pour les consommateurs européens. La décapitalisation du cheptel bovin français, conjuguée à la baisse des prix, pourrait accélérer la conversion des prairies en terres de grandes cultures, moins efficaces pour le stockage du carbone.
Filière volaille : Déjà fragilisée par les importations, la filière volaille française risque de subir de plein fouet la concurrence du Mercosur. Avec un poulet sur deux consommé en France provenant déjà de l’étranger, principalement du Brésil, l’arrivée de 180 000 tonnes supplémentaires pourrait aggraver la situation. Les producteurs français, soumis à des normes sanitaires et environnementales plus strictes, peinent à rivaliser avec les prix bas des volailles sud-américaines. Ce déséquilibre concurrentiel, qualifié de « déloyal » par les professionnels, menace la survie de nombreuses exploitations.
Filière laitière : L’accord présente un double impact pour la filière laitière. L’importation de 30 000 tonnes de fromages européens depuis le Mercosur, bien que représentant un faible volume par rapport à la production européenne totale, constitue une nouvelle source de concurrence. En revanche, l’accord pourrait favoriser l’exportation de certains produits laitiers français vers le Mercosur, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités commerciales. L’impact global reste difficile à évaluer, d’autant que les conditions de travail dans la filière viande sud-américaine suscitent des inquiétudes.
Autres filières et impacts : L’accord Mercosur vise à stimuler le secteur agricole, mais pourrait favoriser les grandes exploitations industrielles au détriment des plus petites. Si certains secteurs, comme le vin (ex: Saint-Émilion) et le beurre, pourraient bénéficier de la levée des droits de douane et de l’accès au marché du Mercosur (270 millions de consommateurs), d’autres filières risquent de souffrir de la concurrence. L’industrie agroalimentaire française pourrait également être tentée de délocaliser sa production vers des pays où les coûts sont moins élevés, entraînant des pertes d’emplois en France. L’impact global de l’accord sur l’économie française reste donc incertain et sujet à débat. Des analyses plus précises, filière par filière, sont nécessaires pour évaluer les conséquences réelles du Mercosur sur l’agriculture et l’emploi en France. L’accord pourrait également offrir des opportunités d’investissement et de développement commercial pour certaines entreprises françaises au sein du Mercosur, notamment dans le secteur du vin, face à des concurrents comme Pernod Ricard.
Les arguments des défenseurs de l’accord
Malgré les inquiétudes exprimées par le secteur de l’élevage, l’accord Mercosur compte aussi ses partisans. Pour ces acteurs économiques et politiques, il s’agit d’une opportunité majeure pour dynamiser les échanges commerciaux et stimuler la croissance des deux continents.
Côté agriculture, certaines filières françaises pourraient tirer leur épingle du jeu grâce à la réduction, voire la suppression, des droits de douane sur leurs exportations. Imaginez : les vins et spiritueux français, mais aussi nos produits laitiers et chocolats, accessibles à 270 millions de consommateurs sud-américains ! Une aubaine pour ces entreprises, qui pourraient ainsi conquérir de nouveaux marchés et accroître leurs ventes.
Et ce n’est pas tout ! 357 appellations géographiques protégées, du Comté au Roquefort, seraient enfin reconnues par le Mercosur. Une victoire pour nos terroirs, et un bouclier renforcé contre les imitations, qui permettra de valoriser le savoir-faire français.
Au-delà des avantages purement économiques, l’accord Mercosur est perçu comme un moyen de tisser des liens plus étroits avec l’Amérique du Sud. Une coopération renforcée, non seulement sur le plan commercial, mais aussi politique, permettant d’aborder des sujets clés tels que l’économie numérique, la recherche et l’environnement. Dans un contexte de compétition mondiale accrue, notamment face à la Chine, le Mercosur est également vu comme un moyen de renforcer la présence de l’UE en Amérique latine.
Cependant, même parmi les défenseurs de l’accord, la nécessité d’harmoniser les normes sanitaires et environnementales entre l’UE et le Mercosur est largement reconnue. Comment concilier libre-échange et respect des critères de la PAC ? Comment garantir une concurrence équitable tout en préservant l’environnement ? Ces questions cruciales, et notamment l’impact de l’accord sur la déforestation en Amazonie, seront abordées dans le chapitre suivant.
L’impact environnemental : un autre sujet de préoccupation
L'accord UE-Mercosur suscite de vives inquiétudes quant à son impact environnemental. L'augmentation de la production de viande bovine, pour satisfaire la demande européenne, risque d'accentuer la déforestation, notamment en Amazonie, comme le souligne le rapport d'experts de 2020.
Si l'accord stipule le respect des normes européennes, la réalité est plus nuancée. Le manque de traçabilité et le recours à l'auto-déclaration pour certains produits, comme les antibiotiques utilisés comme facteurs de croissance, rendent le contrôle difficile. L'Europe interdit l'utilisation d'antibiotiques comme facteurs de croissance, mais autorise l'importation de viande provenant d'animaux élevés avec ces substances, illustrant la complexité de la situation.
La biodiversité est également menacée. L'intensification de l'agriculture au Mercosur, pour répondre à la demande européenne, pourrait fragiliser des écosystèmes et des espèces. Par exemple, des exploitations familiales pourraient être concurrencées par les géants de l'agro-industrie, accentuant la pression sur les ressources naturelles et les populations locales. Les pratiques agricoles divergent entre l'UE et le Mercosur. La Politique agricole commune (PAC) encourage une agriculture plus durable en Europe, avec une limitation de l’usage des pesticides et une prise en compte de la biodiversité. Au Mercosur, les normes environnementales sont moins strictes.
Par ailleurs, le transport de marchandises entre l'Europe et le Mercosur, sur de longues distances, engendre une empreinte carbone significative, aggravant le bilan environnemental global. En France, le déclin de l'élevage herbivore, et la reconversion des prairies en monocultures, pourraient également aggraver la situation. Face à ces défis, il est crucial d'envisager des solutions plus durables pour l'avenir de l'élevage et de l'environnement.
 @Jacques Dillies
@Jacques DilliesQuel avenir pour l’élevage français face au Mercosur ?
L’accord Mercosur pose un défi crucial pour l’élevage français. La concurrence des pays sud-américains, bénéficiant de normes moins contraignantes, menace la viabilité des exploitations françaises. L’importation de viande bovine à tarif préférentiel, même limitée, risque de déstabiliser le marché et d’impacter les revenus des éleveurs, déjà fragilisés par les crises agricoles et climatiques.
Si les défenseurs du Mercosur vantent l’ouverture de nouveaux marchés, l’argument peine à convaincre face aux risques de concurrence déloyale et aux préoccupations environnementales. La déforestation en Amazonie, conséquence potentielle de l’accord, ajoute aux inquiétudes.
L’avenir de l’élevage français dépendra de la capacité du secteur à s’adapter à cette nouvelle donne. Plusieurs pistes de réflexion s’imposent : la mise en place de clauses miroirs pour garantir une concurrence équitable, le renforcement des labels de qualité pour valoriser les productions françaises, et une transition vers des pratiques plus durables pour répondre aux enjeux environnementaux. Le débat reste ouvert, et votre avis compte. Partagez vos réflexions et vos propositions dans les commentaires.