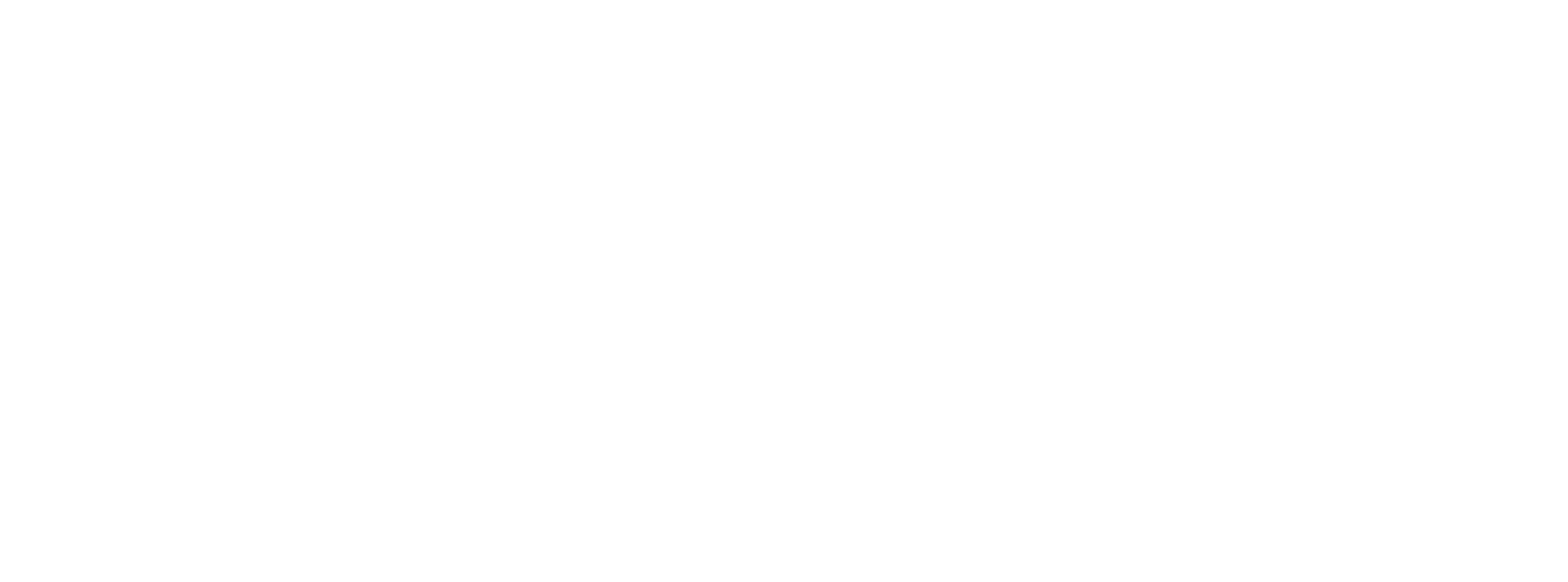Que retenir de l’étude FranceAgriMer sur la consommation de viande des Français hors domicile ?
La viande reste un pilier de l’alimentation en France. Mais entre inflation, crise sanitaire et nouvelles attentes sociétales, les repères évoluent vite. Pour mieux comprendre ce que mangent les Français hors de chez eux, FranceAgriMer a commandé une grande étude sur la consommation alimentaire hors domicile, en particulier sur la filière viande. Réalisée entre 2021 et 2023 par le cabinet GIRA-CIRCANA, cette étude lève le voile sur un marché stratégique, longtemps sous-estimé. Voici ce qu’il faut en retenir.
Un marché en plein essor après le Covid : quelques chiffres
La consommation hors domicile connaît un véritable rebond depuis la crise sanitaire, avec des chiffres en nette progression et une dynamique marquée dans tous les segments de la restauration. Voici les données clés qui illustrent cette croissance :
- 98,3 milliards d’euros de consommation hors domicile en 2023, représentant environ un tiers des dépenses alimentaires des Français.
- +30 % de hausse entre 2021 et 2022, suivi de +10 % supplémentaires en 2023.
- 7,4 milliards de repas servis hors domicile dans les circuits de restauration (traditionnels, rapides, collectifs), redevenus des lieux clés de consommation.
- La restauration commerciale domine le marché, avec près de 60 milliards d’euros de chiffre d'affaires, tirée par les indépendants, même si les chaînes continuent de progresser.
- La restauration collective (cantines scolaires, hôpitaux, entreprises) reste stable, retrouvant progressivement son rythme d'avant-crise.
- 415 000 établissements de restauration recensés en 2023, dont plus de 200 000 restaurants commerciaux.
- Une demande marquée pour le local et le durable, bien que seulement 38 % des viandes utilisées en restauration hors foyer soient d'origine française.
Une reprise marquée pour la viande en restauration
Dans ce paysage en mouvement, la filière viande connaît un rebond significatif. En 2022, le marché des produits carnés hors domicile a atteint 483 000 tonnes, pour un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros. Soit une progression de 43 % en un an. Cette croissance spectaculaire traduit à la fois une reprise d’activité dans les restaurants et une demande qui reste forte. Le frais domine les volumes (56 %), mais les produits surgelés restent bien présents (39 %), surtout en restauration collective. Le prix moyen des produits carnés a augmenté, notamment pour les viandes brutes (type steaks, côtes, morceaux nobles), ce qui a incité certains établissements à revoir leurs approvisionnements ou à réduire les portions servies.
La viande bovine reste un pilier de l’offre, mais subit une pression à la fois économique et structurelle. Elle représente encore une part importante des volumes en restauration, mais sa consommation a reculé de 3,7 % en 2023, atteignant 21,3 kg par habitant. L’inflation, le coût élevé des morceaux nobles, et la recherche de plats plus abordables expliquent en grande partie ce recul. Dans la restauration commerciale, le bœuf conserve une image valorisante, mais il est de plus en plus concurrencé par la volaille ou des plats carnés préparés.
Des choix guidés par le prix, mais aussi par la provenance
L’inflation est un facteur central. Avec une hausse de 12,4 % des prix alimentaires en 2023, les restaurateurs ont dû s’adapter. Beaucoup ont réduit la taille des portions ou opté pour des produits moins chers, quitte à modifier leur offre. La viande de boucherie, par exemple, atteint son plus bas niveau de consommation depuis 2000.
Mais le prix n’est pas le seul critère. De plus en plus de restaurateurs — surtout dans la restauration collective — font attention à l’origine des viandes et à leur conformité avec les critères de la loi EGAlim. Celle-ci impose notamment des produits durables et de qualité, comme le Label Rouge, l’IGP ou le bio. Résultat : les produits labellisés représentent 4 % des volumes, une part encore faible mais en progression.
Malgré cela, la viande française reste minoritaire. En 2022, seulement 38 % des viandes utilisées en restauration hors foyer étaient d’origine France. Un chiffre qui peut surprendre, alors que la demande de local progresse. L’enjeu pour les filières est donc clair : rendre l’offre française plus visible, plus accessible, et mieux adaptée aux réalités économiques des restaurants.
Qui mange quoi, et où ?
L’étude montre que les habitudes alimentaires varient selon les circuits. En restauration collective, le surgelé reste la norme, pour des raisons de logistique, de conservation et de prix. Dans la restauration commerciale, on privilégie le frais, les produits différenciants et les plats signatures. Le segment dit « Impulse » — boulangeries, stations-service, snacking — connaît aussi un fort développement. Ces points de vente représentent désormais 15 % du chiffre d’affaires du hors-domicile. Pratiques, rapides, accessibles : ils séduisent particulièrement les jeunes actifs, les étudiants, et les zones rurales.
Et justement, les jeunes consomment toujours autant de viande. En restauration rapide, dans les fast-foods, les kebabs, les burgers ou les pizzerias, la viande reste très présente. L’image selon laquelle les jeunes se détourneraient massivement de la viande est donc à nuancer. Ils sont plus attentifs à l’origine ou à la qualité, mais ne la boudent pas.
Autre enseignement marquant : les consommateurs de légumineuses ne sont pas ceux qui mangent moins de viande. En réalité, ce sont souvent les mêmes : des ménages de plus de 50 ans, plutôt aisés, et habitant dans le sud de la France. La montée en puissance des pois chiches, lentilles ou haricots secs n’est donc pas un signe d’un rejet de la viande, mais plutôt d’une diversification de l’alimentation.
Un débouché stratégique pour les filières d’élevage
Cette étude met en lumière une réalité souvent oubliée : la restauration hors domicile est un débouché clé pour les filières de l’élevage français.
Mais pour en profiter pleinement, les acteurs doivent s’adapter : proposer des formats pratiques, compatibles avec les contraintes de la restauration ; ajuster les grammages, sans nuire à la qualité ; mieux valoriser l’origine France, notamment dans la restauration rapide et commerciale ; intégrer les labels quand ils sont attendus (notamment en restauration collective) ; se positionner sur le snacking et les nouvelles formes de restauration.
En bref : être réactifs, visibles, et compétitifs. Car même si la demande reste forte, elle évolue vite, et ne pardonne pas les offres mal positionnées.
L’étude FranceAgriMer permet de mieux comprendre les dynamiques actuelles de la consommation de viande hors domicile. Oui, les Français mangent encore de la viande en dehors de chez eux. Oui, les volumes repartent à la hausse. Et oui, les circuits sont nombreux, divers, et porteurs d’opportunités.
Pour les agriculteurs, les éleveurs, les coopératives, c’est un appel à l’action. Il y a des places à prendre dans les assiettes hors domicile. À condition de proposer une offre cohérente, lisible, et connectée aux attentes du terrain. Car plus que jamais, manger de la viande à l’extérieur, c’est aussi faire un choix de société, de territoire, et d’identité alimentaire.
Sources :