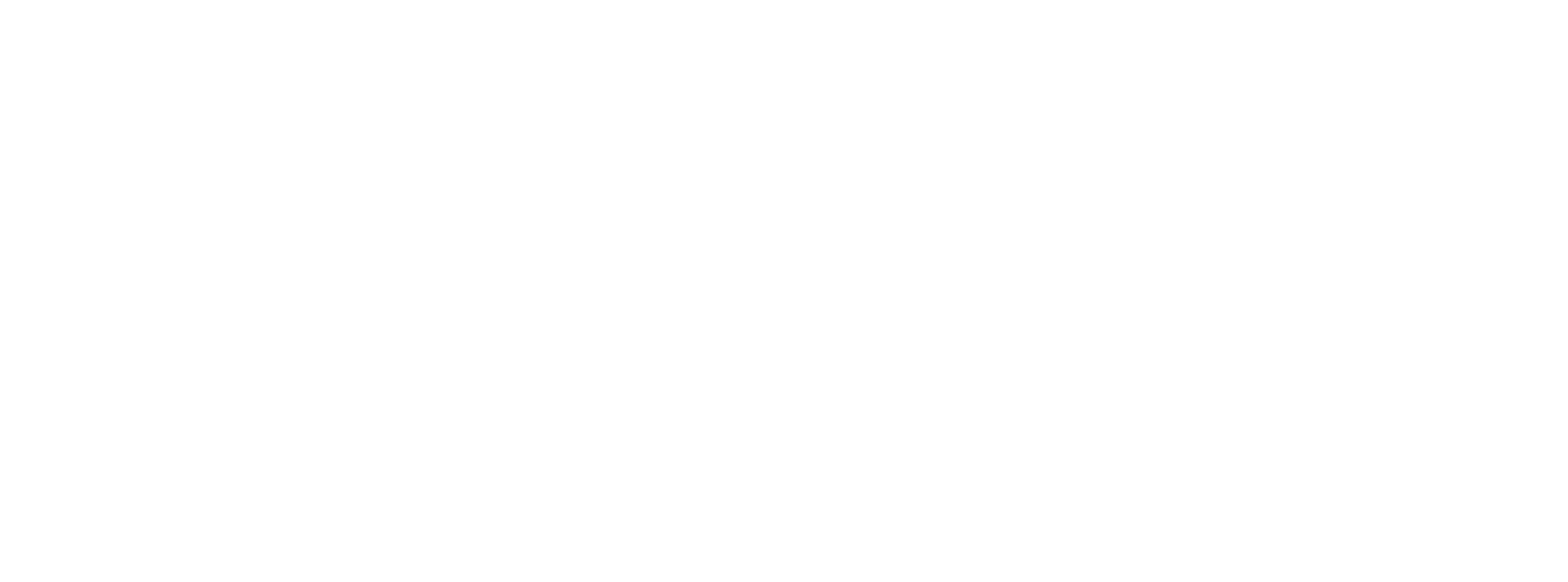Fonds unique, PAC et Von der Leyen : on vous explique tout
L’Union européenne envisage de fusionner le budget de la PAC (Politique Agricole Commune) dans un fonds unique. Cette réforme, portée par Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission Européenne, bouleverse les équilibres actuels et suscite de nombreuses inquiétudes chez les agriculteurs. En jeu : la visibilité des aides, la souveraineté alimentaire, et le rôle de la PAC dans l’économie rurale européenne.
🧱 Une PAC à l’héritage lourd, en mutation
Créée en 1962, la Politique Agricole Commune (PAC) a été l’un des fondements du projet européen. Son objectif : garantir l’autosuffisance alimentaire, soutenir les revenus agricoles et structurer un marché commun. Depuis, elle s’est adaptée à de nombreux enjeux – environnement, territoires, compétitivité – au prix d’une complexification croissante.
Le 16 juillet 2025, la Commission européenne a dévoilé sa nouvelle proposition de réforme pour l’après-2027. Elle promet une simplification radicale, via la fusion des deux piliers historiques de la PAC (aides directes et développement rural), et une intégration budgétaire dans un « Fonds unique », partagé avec d’autres politiques européennes (cohésion, climat, sécurité…).
Il s’agit d’une initiative portée uniquement par la Commission d’Ursula von der Leyen, malgré l’opposition exprimée en amont par le Parlement européen et le Conseil. La présidente de la Commission devra pourtant tenir compte de ces institutions, notamment dans les négociations à venir. Les trilogues s’annoncent déjà tendus.
📉 Budget et cadre budgétaire : vers une PAC moins lisible ?
Le budget de la PAC serait fixé à 300 milliards d’euros sur la période 2028–2034, contre 387 sur la période actuelle – soit une baisse de plus de 20 %. Une clause plancher garantit néanmoins le maintien des paiements directs à ce niveau.
Mais ce qui interpelle, c’est le manque d'autonomie budgétaire. La PAC ne disposerait plus de son enveloppe propre mais serait intégrée à un fonds global, au nom de la flexibilité face aux crises. Une première depuis sa création. Plusieurs organisations agricoles, dont Copa-Cogeca et Farm Europe, dénoncent un risque de dilution politique, de renationalisation implicite et une perte de lisibilité pour les bénéficiaires.
👉 En réalité, cette baisse budgétaire est encore plus marquée car elle ne tient pas compte de l’inflation. En euros constants, le recul du budget est donc bien supérieur aux chiffres annoncés. À cela s’ajoutent d’autres mesures préoccupantes pour le monde agricole.
🔁 Une PAC à géométrie variable ?
L’un des points clefs de la réforme est la subsidiarité accrue accordée aux États membres. Chaque pays définira ses priorités agricoles dans un cadre plus souple, via des « Plans nationaux régionaux » (PNR) intégrant les fonds européens.
La conditionnalité environnementale (BCAE) sera fixée à l’échelle nationale, de même que les aides environnementales ou les critères d’attribution des soutiens couplés. Résultat : des PAC potentiellement très différentes d’un pays à l’autre. Ce qui pose, selon certains, la question de l’équité entre agriculteurs européens.
🚜 Aides simplifiées, mais redistribution renforcée
La réforme prévoit une aide à l’hectare unique et dégressive :
- 25 % à partir de 20 000 €,
- 50 % entre 50 000 et 75 000 €,
- 75 % au-delà de 75 000 €, plafonnée à 100 000 €.
Les aides couplées, possibles jusqu’à 20 % du budget national (contre 15 % aujourd’hui), devront cibler les secteurs en difficulté – élevage extensif, protéagineux… – avec des critères précis comme la densité de cheptel dans les zones vulnérables aux nitrates. Les petits agriculteurs bénéficieront d’un paiement forfaitaire porté à 3 000 €.
👉 À noter que cette nouvelle architecture s’accompagne d’un ciblage renforcé des aides et d’une dégressivité importante, qui selon plusieurs analyses devrait impacter jusqu’à 50 % des éleveurs, particulièrement les plus exposés en termes de surfaces et de charges.
🌱 Environnement et bien-être animal : un nouveau dispositif unique
Les écorégimes disparaissent au profit d’un seul mécanisme environnemental cofinancé, intégrant les mesures agroenvironnementales et climatiques. Il pourra être annuel ou pluriannuel.
Chaque État devra financer des pratiques extensives, l’agriculture biologique et la transition volontaire. Des plafonds d’aides sont prévus pour ces mesures (200 000 €). Un cadre de performance unique, commun à toutes les politiques européennes, évaluera la contribution des dépenses à 4 objectifs : climat, biodiversité, adaptation, inclusion sociale – via un système de notation à 0 %, 40 % ou 100 %.
👥 Un effort appuyé sur le renouvellement générationnel
La réforme consacre 6 % du budget PAC aux jeunes agriculteurs, contre 3 % auparavant.
Les États devront proposer un "starter pack" comprenant aides à l’installation, soutien à la création d’entreprise, formation ou service de remplacement. Les congés maternité, maladie et vacances pourraient ainsi être cofinancés.
🛡️ Une politique de gestion des risques renforcée
Autre priorité : la résilience face aux aléas climatiques et économiques.
La réforme introduit :
- un soutien aux pertes de revenus ou de production dépassant 20 % en moyenne sur 3 ou 5 ans,
- des aides à la restauration du potentiel productif (30 % pour l’agriculture, 20 % pour la forêt),
- et le doublement de la réserve de crise, portée à 900 millions €/an.
🧾 OCM : dénominations de viande, protéines végétales et stocks stratégiques
Enfin, la réforme de l’Organisation Commune des Marchés (OCM) prévoit :
- la création de stocks d’urgence agricoles,
- une clarification des dénominations liées à la viande (protection des termes « steak », « escalope », etc.),
- et un soutien structurant aux cultures protéiques, avec reconnaissance des organisations de producteurs.
📌 Une réforme à suivre de près
Présentée comme une simplification, la réforme interroge sur la pérennité d’une PAC réellement commune, au moment où les défis agricoles (transition, compétitivité, attractivité) sont nombreux.
Autre angle mort pointé par les professionnels : cette réforme ne prend pas en compte l’impact de la politique commerciale européenne actuelle, notamment les accords avec le Mercosur ou l’Australie, portés par la DG Trade. Ces accords pourraient aggraver la pression sur les filières d’élevage, déjà mises à contribution par la future PAC.
Les prochaines étapes – négociation entre États, adoption des règlements, déclinaison dans les plans nationaux – seront déterminantes.
🔎 À retenir :
- Un budget en baisse mais maintenu à un niveau plancher pour les aides directes.
- Une PAC intégrée dans un fonds unique et soumise à un cadre de performance global.
- Une plus grande autonomie laissée aux États, au risque de créer une Europe agricole à deux vitesses.
- Un projet en décalage avec le Parlement, le Conseil… et la réalité des accords commerciaux en cours.
- Des priorités claires : jeunes, environnement, gestion des risques.