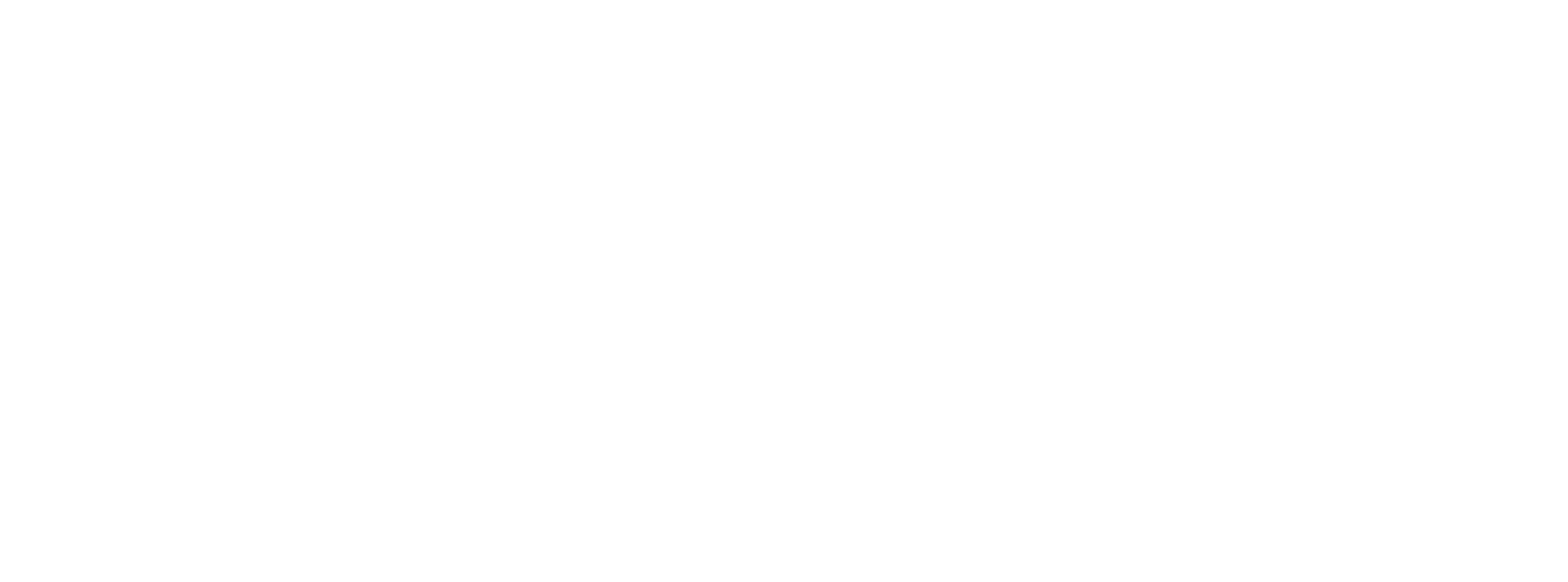Agroforesterie et élevage bovin : une alliance pour un avenir durable
Dans un contexte de transition écologique et d’adaptation au changement climatique, une pratique agricole ancienne revient sur le devant de la scène : l’agroforesterie. Planter des arbres au cœur des pâturages ou en bordure des parcelles, c’est renouer avec une vision plus complète de l’agriculture. Une agriculture qui conjugue résilience, performance et durabilité.
Replacer l’arbre au cœur de l’élevage
L’agroforesterie, c’est l’association d’arbres avec des cultures ou de l’élevage sur une même parcelle. Dans le cas de l’élevage bovin, cela prend la forme de prés-vergers, de parcours arborés ou de systèmes sylvopastoraux. L’objectif : créer un environnement plus riche, plus équilibré et plus autonome.
Cette approche n’est pas nouvelle : les campagnes étaient autrefois couvertes de haies, de vergers pâturés et de prairies arborées. Aujourd’hui, ces modèles retrouvent toute leur pertinence face aux enjeux actuels : perte de biodiversité, épuisement des sols, aléas climatiques ou encore hausse des coûts de production. Dans un élevage agroforestier, les arbres sont des éléments structurants du système. Ils offrent une diversité d’usages : ombrage, fourrage, production de bois, abri pour la faune auxiliaire... Et surtout, ils reconnectent l’élevage à son territoire.
Des bénéfices à tous les niveaux
Pour les bovins
Les arbres créent de l’ombre et un abri naturel. En période de forte chaleur, ils permettent aux vaches de mieux réguler leur température corporelle, de limiter leur stress et donc de préserver leur santé. On observe dans plusieurs élevages une amélioration du comportement des animaux et de meilleures performances de reproduction. Les veaux bénéficient aussi d’un environnement plus tempéré, ce qui peut favoriser leur croissance. Le bien-être animal devient ainsi un facteur de performance et non une contrainte.
Pour les prairies
L’arbre modifie le microclimat local : il réduit l’évapotranspiration, augmente la rétention d’eau dans le sol, et protège l’herbe des vents desséchants. Résultat : une herbe plus grasse, plus nutritive et une saison de pâturage allongée. Pour l’éleveur, cela signifie moins de compléments à distribuer et une autonomie alimentaire renforcée.
En période de canicule, certaines zones ombragées conservent une activité végétative que les autres perdent. Cela permet aux éleveurs de limiter le recours à l’ensilage ou à l’achat de fourrages extérieurs.
Pour l’exploitation
Les arbres représentent une valeur ajoutée : bois d’œuvre, bois énergie, fruits, BRF… Cette diversité permet de sécuriser les revenus sur le long terme. Ils jouent aussi un rôle de bouclier écologique : ralentissement de l’érosion, captation du carbone, stabilisation des pentes. Enfin, ils améliorent l’image de l’exploitation auprès du public et des consommateurs.
Une réponse concrète aux défis environnementaux
L’agroforesterie répond à plusieurs enjeux majeurs :
- Stockage du carbone dans la biomasse et dans les sols
- Protection de la ressource en eau grâce à un meilleur fonctionnement des sols
- Préservation de la biodiversité (oiseaux, pollinisateurs, microfaune)
- Résilience climatique : adaptation face à la sécheresse, aux vents, aux inondations
En augmentant la matière organique, en réduisant l’érosion et en améliorant l’infiltration de l’eau, l’agroforesterie améliore aussi la fertilité naturelle des sols. C’est un levier stratégique reconnu par de nombreux experts, notamment dans le rapport du GIEC de 2019 sur l’usage des terres. L’agroforesterie y est identifiée comme un levier efficace pour l’atténuation du changement climatique et la sécurisation de la production alimentaire mondiale.
Un intérêt économique souvent sous-estimé
Beaucoup pensent que l’agroforesterie fait perdre de la surface utile, mais ce n'est pas le cas dans la majorité des cas. Bien conçue, la perte de rendement est marginale, souvent inférieure à 5 %, et largement compensée par les gains économiques indirects. Exemple : en produisant ses propres copeaux pour la litière, un éleveur peut réduire significativement ses dépenses en paille.
Autre avantage : les arbres fixateurs d’azote (acacia, robinier…) peuvent améliorer la fertilité des sols et réduire le recours aux engrais azotés. Enfin, la diversification des revenus (bois, fruits, services environnementaux) renforce la stabilité économique de l’exploitation.
Bonne nouvelle : les agriculteurs ne sont pas seuls. Des aides financières existent à tous les niveaux.
- La PAC reconnaît les parcelles agroforestières comme agricoles (dans la limite de 200 arbres/ha)
- Des aides à l’investissement via les sous-mesures 4.4 et 8.2
- Le programme « Plantons des haies ! » doté de 50 M€ pour 2021-2022
- Des dispositifs régionaux ou départementaux complémentaires
Le Pacte en faveur de la haie, lancé en 2023, vise à structurer les filières, former les agriculteurs, et intégrer l’arbre dans les logiques territoriales de développement rural.
Voici un article pour en savoir plus sur les règlementations autour de la plantation de haies !
Bien préparer son projet d’agroforesterie
Un projet réussi repose sur une bonne conception en amont. Cela implique de :
- Choisir les essences adaptées au sol, au climat, aux objectifs
- Définir l’espacement entre les arbres selon les outils disponibles
- Intégrer la plantation dans le plan de rotation ou de pâturage
- Penser la gestion à long terme (taille, valorisation, entretien)
D’autres éléments entrent en ligne de compte : l’exposition, la pente, le risque de dégâts par les animaux, ou encore l’accès à l’eau. Tous ces paramètres influencent la réussite du projet.
Les Chambres d’agriculture, les CIVAM ou des structures spécialisées comme le RMT Agroforesterie proposent un accompagnement technique personnalisé. Le suivi régulier, l’entretien des jeunes plants, la protection contre le gibier sont aussi des points clés souvent sous-estimés.
Et sur le terrain, ça donne quoi ?
Le Concours Général Agricole des Pratiques Agro-écologiques récompense chaque année des exploitations agroforestières exemplaires. Parmi les lauréats : des éleveurs laitiers, des producteurs de viande, ou encore des polyculteurs-éleveurs qui ont réussi à intégrer harmonieusement arbres et animaux.
L'agroforesterie est est déjà mise en œuvre dans des systèmes divers, en plaine comme en zone de montagne, en bio comme en conventionnel. Des plateformes comme le RMT Agroforesterie ou les réseaux de Chambres d’agriculture permettent d’accéder à des retours terrain, des données technico-économiques et des outils pratiques pour se lancer. L’expérience accumulée ces dernières années donne un cap : oui, il est possible de concilier production, environnement et durabilité à l’échelle d’une exploitation.
Adopter l’agroforesterie, c’est repenser son système pour gagner en robustesse, en autonomie et en cohérence écologique. C’est concevoir l’élevage comme un système vivant, multifonctionnel, qui tire profit de chaque élément du paysage. L’agroforesterie bovine est une solution de bon sens, porteuse d’avenir. Et si demain, chaque arbre planté devenait un pilier de la performance agroécologique ?